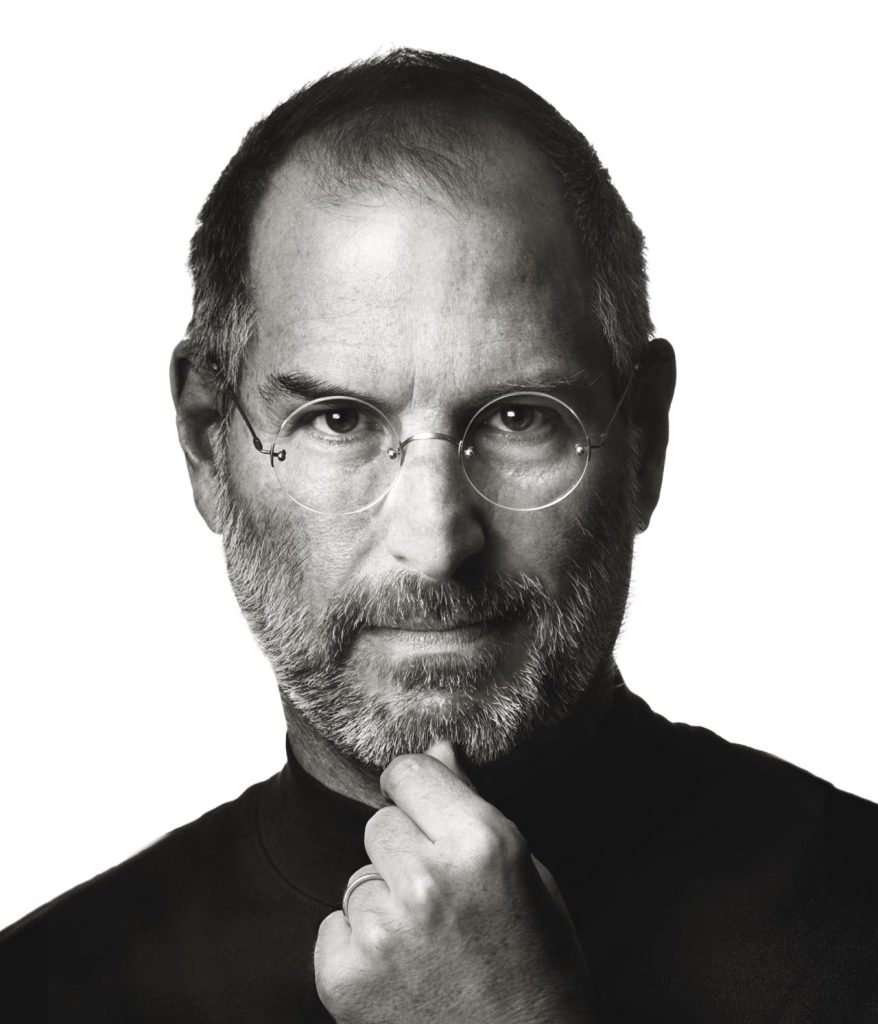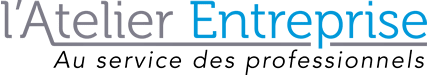La prévention avant tout
Les compagnies d’assurance mettent en place des programmes de prévention et de sensibilisation :
- Formation des collaborateurs à repérer les comportements suspects,
- Mise à jour régulière d’une cartographie des risques,
- Diffusion d’informations auprès des assurés sur les contrôles existants,
- Collaboration étroite avec les autorités et les organismes de régulation comme la CNIL (notamment via le cadre RGPD et le “pack conformité assurance”).
L’objectif : décourager les fraudeurs potentiels avant le passage à l’acte.
La détection grâce à la technologie
Les outils modernes s’appuient sur :
- L’intelligence artificielle (IA) et le machine learning pour analyser les déclarations,
- Le croisement des bases de données (antécédents, fréquence de sinistres, adresses, signatures, etc.),
- Des alertes automatiques lorsqu’un dossier présente des incohérences.
Quelques signaux d’alerte typiques :
- Changement de RIB ou de bénéficiaire juste avant un sinistre,
- Sinistre déclaré peu après la souscription,
- Documents illisibles, falsifiés ou raturés,
- Plusieurs sinistres rapprochés pour un même bien,
- Déclaration d’un incendie sans cause déterminée.
Les enquêtes et contrôles
En cas de soupçon, l’assureur procède à :
- Des vérifications documentaires (factures, signatures, RIB, devis),
- Des enquêtes de terrain, voire la consultation d’enquêteurs privés,
- Une analyse approfondie avant toute décision.
Si la fraude est avérée, l’assureur peut :
- Signaler l’affaire à l’ALFA, pour démanteler d’éventuels réseaux,
Ou transmettre une déclaration de soupçon à TRACFIN, notamment en cas de blanchiment ou de financement du terrorisme.